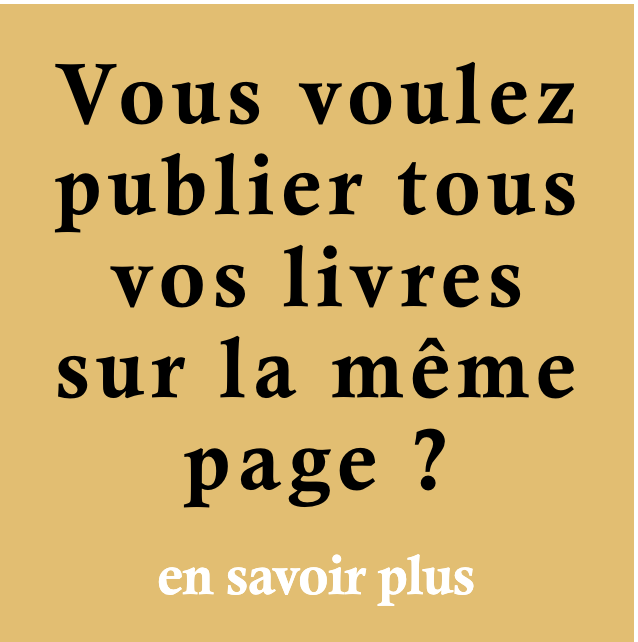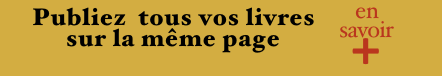
Entendre : Coup de coeur du concours de nouvelles monBestSeller 2019

Elle a cinq ans. Elle s’appelle Corinne. Elle est petite pour son âge, on pense qu’elle s’allongera en grandissant. Il faut dire qu’elle ne se dépense pas beaucoup. Sa mère n’aime pas la laisser jouer trop longtemps, surtout avec d’autres enfants. Corinne adore les puzzles, les jeux de construction, les livres à colorier. Elle remplit les images sans jamais déborder, elle aime accorder les couleurs. Elle connaît toutes les lettres de l’alphabet et la signification des chiffres. Elle peut rester des heures dans sa chambre entourée de ses jouets. Elle a inventé un langage sans mots, fait de bruits, de gestes, de mimiques. Elle joue tous les rôles, le sien d’abord, celui de ses poupées, de ses animaux en peluche. Elle est le cheval, la fée, la marchande, la cabane, la forêt, la mer et même le sable. Elle n’invente rien, tout existe, donc tout est vrai, c’est logique. Elle est allée un peu à la petite école de son village. Elle a vu sa mère parler avec la maîtresse, Madame Paganucci. C’est une large femme avec des jambes en poteaux, qui fait des grimaces. Corinne a l’impression qu’elle la prend pour un petit singe. Madame Paganucci frappe sur son bureau avec une règle, fouille dans les pupitres, envoie les agités au piquet. Ils gardent les mains dans le dos, ne doivent plus bouger, ni se retourner. On a installé Corinne au fond de la classe, elle a été inscrite en retard, les places aux premiers rangs ont été prises, on ne peut pas les changer. Ça ne la dérange pas, Corinne a l’habitude de retenir ce qu’elle voit, même de loin. Pendant les récréations, elle a essayé de faire la ronde autour de l’arbre avec les enfants. Ils ne l’ont pas laissée entrer. Ils ont crié. Elle connaît le cri, c’est comme une pierre lancée sur la peau, ça n’entraîne jamais rien de bon. Elle ne pleure pas. Le chagrin reste coincé, ça lui appuie dans le ventre comme un morceau de pain trop gros. Dans la classe, elle recopie sur une feuille à double ligne les lettres écrites au tableau, c’est facile. Quand elle essaie de parler, elle sent des picotements autour de la tête, ça fait ces sons bizarres, elle n’entend pas ce qu’elle dit. On se moque d’elle, on l’imite. Elle rit aussi, elle a compris qu’il vaut mieux.
Un jour, sa mère l’a bien habillée, bien coiffée, elle l’a amenée en ville. Elles sont entrées dans un immeuble, puis dans une pièce avec une dame en blanc. Elles se sont assises sur des chaises douces et molles. Un peu plus tard, un monsieur avec une tête de curé les a fait entrer dans un petit box. C’est tout fermé, avec de gros fils en caoutchouc et des boutons comme les lumignons de Noël. Le monsieur porte une chemise bleue à fines rayures et un costume gris foncé. Il a des gestes calmes, des mains froides, une odeur sérieuse. Il pose sur la tête de Corinne un gros casque noir. Elle n’a pas peur, au contraire, ça lui plaît d’être cosmonaute. Elle doit lever la main quand il y a quelque chose dans le casque, même si c’est tout petit, très loin. C’est difficile à attraper. Ça ressemble un peu aux camions qui passent sur la route et font beaucoup de poussière, vron, vron, vron. Ou quand les ouvriers enfoncent, en sursautant, un gros marteau dans le trottoir, kla, kla, kla. Parfois, c’est comme le souffle violet des nuages qui dévalentavec la force du vent. C’est fini, on lui ôte le casque. Sa mère fait une drôle de mine. Ses yeux ont des larmes qui ne coulent pas, elle hoche la tête lentement quand le monsieur lui parle. Corinne a compris de quoi il s’agit, ça fait longtemps qu’elle le sait.
Il faut partir. Un autocar jaune et bleu les ramène au village. Corinne court bien plus vite que le vieux moteur. Elle saute par-dessus les collines étouffées de maquis, enjambe les routes, les ruisseaux et les ponts. Quand elles arrivent à la maison, sa mère lui fait comprendre que demain, elles retourneront en ville et iront à la grande pharmacie du Cours.
Corinne la connaît, cette pharmacie. Ça sent le Vicks pour respirer et l’alcool qui pique sur les genoux. Il y a toujours des vieux qui toussent, des gens qui prennent toute la place avec des feuilles à la main, deux dames à lunettes très affairées, qu’on ne voit qu’à moitié.
Un homme vient chercher Corinne et sa mère. Celui-là leur sourit, il sent la pommade et mâche de la gomme. Il les entraîne au fond, dans une pièce où il fait sombre. Il y a là des bouteilles aux noms bizarres, des cartons entassés, des piles de papiers si hautes qu’elles tournent comme des escaliers en colimaçon. Le monsieur fait un geste du bras, secoue la tête, déplorant d’un air désolé cet incroyable fatras. Il fait asseoir Corinne sur un tabouret en métal et s’en va farfouiller derrière un meuble. Il revient avec un pot vert et l’autre blanc. Il en extrait des textures qu’il malaxe longuement. Corinne pense à de la pâte à modeler. Elle sait façonner des petits vases, des petits chiens, des bonshommes qui ne tiennent jamais debout. Le monsieur introduit le mélange dans une seringue. Elle en a déjà vu quand l’infirmière soignait sa grand-mère. L’homme a de gros doigts, ce n’est pas facile. Corinne a peur cette fois, mais elle ne bronche pas. Avec une maladroite douceur, il introduit la seringue dans ses oreilles, l’une après l’autre, en appuyant sur le piston. Ça ne fait pas mal du tout. C’est comme de la mie fraîche qui se met à gonfler, puis à déborder. Corinne peut se voir dans un miroir. Elle ressemble à la tête du cochon persillé qu’elle a vue à Noël sur l’étal de Pierrot, le boucher du village. Sa mère n’a pas envie de rire. Quand les empreintes sont sèches, l’homme les retire doucement. Il en fera des embouts définitifs. Il sourit toujours, Corinne aperçoit le morceau de gomme qui se promène dans sa bouche. Puis, il lui montre deux gros haricots attachés à des embouts transparents, comme des mollusques sortis de leur coquille. Ce n’est pas très joli. Il va les placer dans les oreilles de Corinne, juste pour les essayer.
L’homme ne sourit plus. Il regarde la mère, lui fait signe de parler.
C’est à cet instant-là qu’il actionne les appareils.
C’est à cet instant-là que pour la première fois, je t’ai entendue, maman.
Tu te tiens derrière moi et partout en même temps. C’est de la pluie très douce dans mon dos, sur mes bras, sur mes jambes. C’est un souffle frais, coloré, qui entre dans ma tête, sort par mon ventre et danse autour de moi. Un souffle qui prendra la forme que je veux. Entendre, c’est attraper de l’air et le garder dans ses mains. Maman. Je suis sourde mais je reconnais ta voix, je l’ai toujours entendue dans les lueurs de ton regard. C’est un écho voilé, régulier, un peu triste. Sans te voir, je sais à cet instant que tu souris et je sais que tu pleures. Tes paroles sont des oiseaux, comme ceux de la forêt de ma chambre. Ils s’envolent, ils se posent, ils reviennent. Je saurai vite les apprivoiser, j’ai l’habitude, ne t’inquiète pas. Et j’ai toute la vie devant moi.
Ajaccio, 1975.

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…