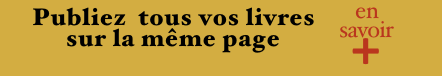La prostituée : Coup de coeur du Concours de nouvelles monBestSeller 2019

La Prostituée de Foucaut
Mon père avait toujours exercé le métier d’antiquaire et brocanteur. Il avait un magasin à Aubervilliers au nord de Paris et s’était spécialisé dans les instruments médicaux. Je le vois encore dans son local exigu qui débordait d’objets en tous genres.
J’étais souvent fourré dans sa boutique et dès l’âge de douze ans, j’arrivais à renseigner certains clients. J’aimais surtout les objets bizarres, ceux qui avaient une histoire que mon père se plaisait à raconter. J’étais son premier public ! Je pense qu’il en enjolivait certaines ; je le suspecte même d’en avoir inventé quelques-unes, mais c’était la loi du commerce et les affaires l’exigeaient.
Un jour, il avait rapporté d’une vente un gastroscope mis au point en 1932. Il servait à examiner l’estomac.
Mon père disait, mais personne n’aurait pu vérifier si c’était vrai, que c’était précisément avec cet appareil que l’on avait retrouvé un louis d’or dans l’estomac d’un patient. Il l’avait avalé accidentellement et ce n’est que des années après qu’il s’était fait examiner alors qu’il souffrait de douleurs gastriques.
Mon père aimait terminer son histoire en disant qu’il y avait meilleure façon de placer ses économies, ce qui faisait bien rire les clients du magasin.
Et il ajoutait à mon adresse :
- Tu sais, Gérard, fais rire un client et la moitié de la vente est faite. Raconte-lui une belle histoire et le prix en sera doublé !
Petit à petit, il avait acheté d’autres objets d’usage médical dans les ventes des domaines ou même aux puces de Saint-Ouen où certains brocanteurs avaient déniché quelques pièces rares, mais n’avaient pas la clientèle qui convenait pour les vendre.
L’inspiration, qu’il avait fertile, lui dictait des histoires plus rocambolesques ou plus folles les unes que les autres.
- Vous voyez, disait-il, c’est avec cet objet que le médecin personnel de Louis II de Bavière lui inspectait le trou du cul. Car comme chacun sait, il souffrait d’hémorroïdes.
Personne n’y croyait bien sûr, mais la bonne humeur était de règle.
Des junkies à la recherche de seringues étaient un jour entrés au magasin et mon père s’était foutu d’eux en leur présentant une seringue de grande capacité que l’on utilisait dans les zoos pour nourrir les gros mammifères. Comme ceux-ci manquaient d’humour, mon père s’en sortit avec un peu de casse dans son magasin et des injures à la pelle.
Mais ce n’était pas là le pire.
J’étais au collège à cette époque-là et un soir, alors que je rentrais,mon cartable à la main, je fus interpellé par ces junkies qui m’avaient reconnu. Sans doute m’avaient-ils vu dans la boutique.
- C’est toi le fils du gros connard qui se paie notre tête avec ses putains de seringues ? me demandèrent-ils.
Je ne savais pas quoi répondre. Ils me faisaient peur avec leurs têtes de déterrés et leurs habits en piteux état. Ils étaient quatre et deux d’entre eux avaient des chiens qui tiraient sur leur laisse en aboyant dans ma direction, attisés par l’agressivité de leurs maîtres.
Je n’en menais pas large, mais coincé par les quatre individus, je ne pouvais m’enfuir.
Je ne sais pas si cela fut volontaire ou pas. À un moment, l’un d’eux lâcha son chien ou peut-être le chien lui échappa. D’un bond, il se jeta sur moi. Je tombais violemment en arrière, les jambes écartées et le chien me mordit les testicules.
Je perdis connaissance et ce n’est que le lendemain que je me réveillais sur un lit d’hôpital.
On m’avait ramassé, inconscient, dans une mare de sang. Les junkies avaient fui et ce sont des passants qui avaient appelé les secours.
Le chien m’avait gravement blessé, arrachant quasiment la totalité d’un testicule et me laissant un pénis dans un état désastreux et de multiples plaies de la face interne des cuisses.
Je suis resté pendant des semaines à l’hôpital subissant plusieurs opérations et notamment une chirurgie réparatrice du pénis et la pose d’une prothèse testiculaire.
Ces opérations me redonnèrent un semblant d’anatomie, mais jamais je ne pourrais avoir d’érections et encore moins d’enfants.
Après des mois de souffrance et les conséquences irréversibles de cette agression, je me sentais profondément meurtri, dégoûté par une telle injustice que je ne pouvais pas accepter. J’aurais voulu prendre un fusil et leur tirer une balle dans les couilles pour qu’ils sachent ce que j’avais ressenti. Mais je ne le fis pas et je suis resté ainsi en rongeant mon frein.
Je n’osais pas sortir ; rencontrer une femme m’était impossible. J’avais l’impression qu’elle verrait mon infirmité dans mon regard, comme si j’avais une paire de couilles à la place du nez. Je ne pouvais pas séduire, je voyais en moi un monstre qui me faisait horreur.
J’avais alors vingt ans et n’avais encore jamais eu de relations sexuelles. Un jour, prenant mon courage à deux mains, je me rendis rue Saint-Denis à la recherche d’une prostituée. Elle me fit monter dans une chambre sordide dans laquelle un parfum de violette tentait, sans y parvenir, de cacher une odeur âcre de sperme. La chambre était sale. On y montait par un escalier étroit où l’on pouvait rencontrer à tout moment des clients qui descendaient en détournant leur regard.
Ce fut un désastre. La première épreuve fut de me déshabiller, je sentais la honte monter en moi, je devinais mon visage écarlate.
Je souffrais encore des séquelles de mes opérations et rien ne pourrait y faire ; bander m’était irrémédiablement impossible. Elle essaya ce qu’elle pouvait, mais je savais qu’elle n’y pourrait rien malgré toute son expérience.
Je me suis demandé alors pour quelle raison je l’avais suivie. À quel miracle devais-je m’attendre ? Ce n’était qu’une pute pas une magicienne et c’était rue Saint-Denis, ce n’était pas Lourdes.
Lorsqu’elle se rendit compte de son échec, elle arrêta ses caresses et je vis dans ses yeux un sentiment de profonde compassion.
Je lui tendis un billet de 500 francs en espérant qu’elle se taise et qu’elle ne se mette pas à rire de moi. Elle les prit en déposant sur ma joue un baiser que je pris comme un geste de tendresse.
C’était ma première aventure sexuelle, mais ce fut en même temps ma dernière expérience.
De retour dans la rue, j’étais triste à mourir. Glissant mes mains dans les poches de ma veste, j’y découvris mon billet.
Vingt minutes plus tard, je revenais à l’endroit où j’avais rencontré la fille. Elle était là, sur le trottoir, dans l’attente d’un nouveau client.
Caché à l’angle d’une rue, j’interpellais un jeune homme qui passait par là. Suivant mes instructions, il se dirigea vers la fille, et lui tendit le bouquet de roses rougesque je lui destinais.
Elle le regarda, surprise, puis observa la rue dans toutes les directions. Je pus lire sur ses lèvres un sourire et dans ses yeux une larme.
Ce n’était pas une pute, c’était une reine !
Je quittai les lieux discrètement et ne la revis jamais. Elle n’avait pas guéri mes blessures physiques, mais elle m’avait redonné confiance en l’âme humaine.

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…