
Roman, essai : l'humour pour conquérir le lecteur et ciseler la pensée
 Je suis plus qu’enthousiaste devant l’émergence de ces espaces culturels démocratiques qui permettent à tant d’inconnus d’entrer dans la lumière
Je suis plus qu’enthousiaste devant l’émergence de ces espaces culturels démocratiques qui permettent à tant d’inconnus d’entrer dans la lumièreVous êtes d’abord un facétieux impertinent, qui s’amuse des mots, des concepts, des situations. C’est une posture d’écrivain, ou une posture de vie ?
Je ne crois pas qu’il soit possible de dissocier absolument l’individu de l’auteur. Je suis, en ce qui me concerne, plus « authentique » dans l’écriture que dans la vie courante. Cela peut sembler paradoxal, mais le « nom d’auteur » est à mon sens plus proche d’être un révélateur chimique de qui nous sommes vraiment que celui que nous portons au quotidien. Je n’oublie pas que la persona était d’abord pour les latins le masque de l’acteur. Pour ce qui est du ton humoristique que vous pointez, il tient en grande partie à sa puissance critique, ludique et heuristique. Autocritique, aussi ; parce qu’on ne l’est jamais assez. L’humour est une posture. L’humour est une nature. C’est également un style que l’on gagne à cultiver. Rappelons qu’« humour », en langue classique, est synonyme d’« esprit ». À rebours de leurs prédécesseurs classiques qui savaient l’art et la manière d’en faire une servante de la philosophie, je note avec tristesse que les prétendus « penseurs » modernes en manquent singulièrement. Trop d’amour-propre détruit l’humour en propre. Disons que le rire n’est pas le propre de l’homme, mais il n’est jamais sale.
Le hippie, le lascar, le hacker… dans Sociologie des marges, vous égrenez les typologies de marginaux. On comprend derrière les portraits tracés, dont on saisit rapidement l’essence, la richesse des références. On s’amuse bien. Par la multiplicité de références culturelles, vous mettez à distance (certainement pas mal de lecteurs), est ce que ce livre pourrait exister sans ces références, ou plus léger… ?
L’un de mes premiers livres, dont le péché de jeunesse était de vouloir trop en dire. D’aller parfois plus loin qu’il ne l’aurait fallu sans remettre au lecteur le tournevis sonique de cette grosse et dense machine. « Trop de notes, mon cher Mozart ! » Quel rapport entre le royaume d’Argot et les conjurations de la Terre creuse ? Entre un système évolutif et le bateau de Thésée ? Entre le nazisme et la langue-mère d’avant Babel ? Entre les confréries de biker et les rites de passage ? Entre le bouddha Siddhârta, Jésus, et le Mahatma Gandhi ? Entre l’hyménoptère blastophaga psenes et le fantasme de la fusion homme-machine ? Tisser des liens entre des phénomènes apparemment déconnectés, expliquer l’eau par les poneys, c’était tout le tour de force de la Sociologie des marges. Beaucoup de réflexions rentrées qui n’attendaient qu’une occasion pour prendre forme. J’ai néanmoins l’espoir que l’apparente difficulté d’accès de l’ouvrage ne sera pas un obstacle insurmontable aux yeux de lecteurs curieux. L’humour et l’écriture ont là encore une place à faire valoir.
En avant avec une fiole d’acide chlorhydrique avec l’Apologie de Strauss-Kahn (qui d’ailleurs en concerne beaucoup d’autres) ou le jeu d’écriture et du bon mot prime. On se laisse porter par les hypothèses, les divagations, et suppositions. On ne distingue plus le vrai du faux, l’info de l’intox. Quelle est l’intention ?
Un mot, pour dissiper d’avance tout risque de quiproquos. Qu’on ne se laisse pas berner par la titraille en forme d’antiphrase : d’apologie, n’est en rien question. Pas au premier degré. L’Apologie est partie d’un certain ras-le-bol quant à l’omniprésence du commentaire autorisé sur les boires et déboires d’une certaine hyperclasse qui n’avait rien de mieux à foutre qu’à foutre (si j’ose m’autoriser cette infraction au code de la bonne conversation). Tout ce qui a trait au volet judiciaire de la question relève de la satire ; il ne faut rien y lire de plus. – Ou serait en pure perte, tant la réalité fait profession de garder toujours un décimètre d’avance sur l’« affliction ». J’ajoute, comme vous le remarquez, que DSK est loin d’être le seul larron à profiter de mes humeurs gouailleuses.
Affaire ou pas, je n’ai rien sacrifié de l’éclectisme qui fait souvent le sel des grands récits (de ce qui nous écrivent, au lieu que nous les écrivions). La (non-)Apologie de Strauss-Kahn se veut donc aussi un essaimage logique de dissertations sur les pâtés de fœtus au miel et à la menthe poivrée, sur le rapport de la théologie à la sexualité au Moyen Âge, sur l’unité des vices et sur la réflexologie plantaire (il faut de tout pour faire immonde). Tout cela accommodé à la sauce « romanquête », relevé d’une pointe de thriller judiciaire. C’est un peu Umberto Eco en rade à Sin City. Quoi d’autre ? Du style, du calembour, de l’humour avec un « H » bien gras. On en trouvera aussi. Et pas que de bon goût… Qui peut encore douter que mes intentions sont nobles ?
Ecrivez-vous pour vous et pour vos proches ? Ou dans une optique d’édition ? Est-ce que cela changerait votre façon d’écrire ?
Pour moi, on peut le dire : personne ne m’a forcé. Je ne force pas non plus mes proches ; donc je suppose qu’ils y trouvent également leur compte. Pour être tout à fait honnête, mon lectorat ne s’étend pas au-delà du premier cercle (mais c’est un cercle très vertueux). Je n’exclus pas, bien sûr, de publier « en dur ». Le temps de l’édition viendra. Peut-être. Cela supposera tout de même rassemblées plusieurs conditions :
- D’abord qu’un éditeur juge mes écrits dignes d’être diffusés. Je ne suis pas fils d’acteur/chanteur/journaliste, je n’ai donc pas de talent congénital à faire valoir ou de prédisposition à la vente longue. Il lui faudra se contenter de mes écrits. Chose rare en ces temps d’adultère promotionnel, il lui faudra les lire.
- Ensuite, que cet éditeur m’accepte comme je suis, sans vouloir faire de moi ce que je ne suis pas. Sans entamer ma liberté. Sans, par exemple, caviarder mes excès des Nouveaux Texticules et du Miroir aux Alouates, dont je conçois pourtant qu’ils finiront par me retrouver dessus. Cela répond en partie à votre dernière question.
Corriger sans dénaturer, rectifier sans détruire, c’est un art délicat. C’est l’art de l’éditeur qu’il faut d’abord séduire – « conduire à soi » – en qualité de premier lecteur. Le style est en cela l’analogue du charme : il faut savoir tourner la langue pour embrasser correctement. Voyez qu’il y a beaucoup à voir avec la relation de couple – celle-là qu’on ne cesse de proclamer « en crise ».
Visiblement ces ouvrages ont été publiés. Ou très soignés dans leur présentation. Diffusés ? Vous n’avez visiblement pas hésité à les mettre en ligne. Quel est le plaisir de se mesurer à quelques lecteurs ?
Publiés, oui et non. Ils sont pour la plupart disponibles en autoédition ainsi qu’en PDF. En accès libre s’entend. Mon objectif n’est pas de vendre. Il ne l’a jamais été. Je ne cherche pas d’abord à publier : j’écris et je publie, je n’écris pas pour publier. Cela implique beaucoup de choses. D’abord, une certaine liberté de ton ; ce qui rejoint la question précédente. Je n’ai aucun filtre éditorial. Je suis un in-filtré. Je ne pisse pas, comme Zeus, à travers un tamis. Ensuite, une forme d’exposition qui me confronte à des lecteurs qui ne sont pas déjà acquis à ma façon de penser ; c’est-à-dire pas au point de dégainer la MasterCard. Je m’attends donc à des critiques moins indulgentes et peut-être plus justes que celle de mon entourage. On ne progresse qu’à ce prix. La route est longue et j’ai encore beaucoup de coups à prendre… Les avis positifs sont toutefois, pour la même raison, les plus encourageants.

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…

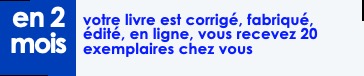



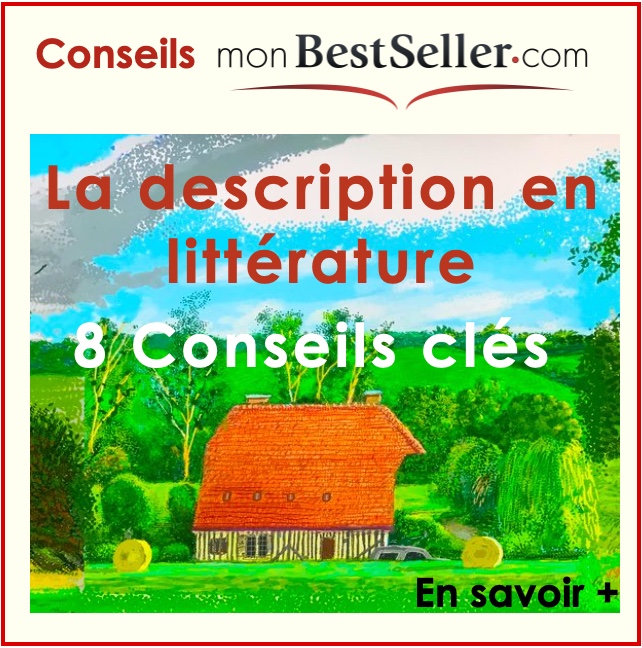


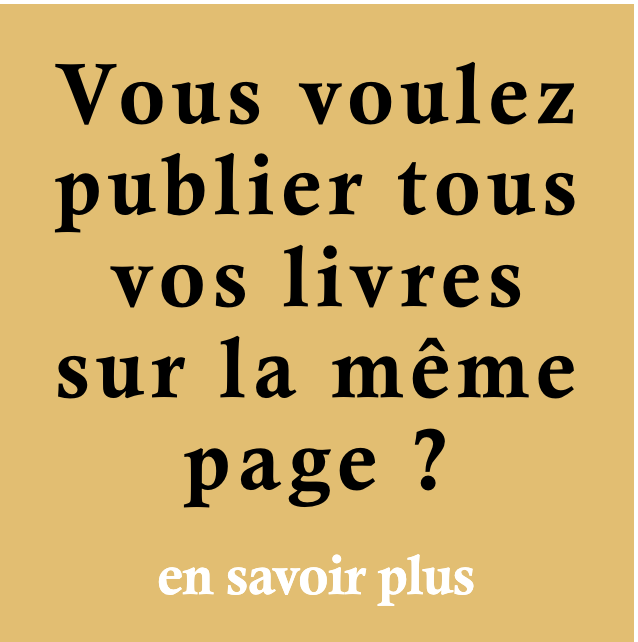


Excellente interview. Bravo !
"plus authentique dans l’écriture que dans la vie courante" : je partage cette idée moi aussi, selon laquelle il est plus facile d'être soi dans l'écriture. On a beau s'inventer des histoires, rien n'est plus vrai que l'âme qu'on y glisse entre les mots.
Concernant l'humour, je crois qu'il est une forme d'amour (et c'est pour cette raison que j'ai associé les deux dans mon premier roman). L'autodérision est un élément essentiel du développement personnel, une des meilleures graines de l'estime de soi. Elle est le début d'un amour de soi qui nous relie aux autres, et donc différent de l'amour propre, qui tend parfois à se ternir en nombrilisme ;-)
Enfin, cette phrase m'a fait sourire : "que cet éditeur m’accepte comme je suis, sans vouloir faire de moi ce que je ne suis pas. Sans entamer ma liberté" Parce que les trois quarts des autoédités (source mon sondage auprès de 130 auteurs francophones) tiennent à l'autoédition justement pour cette raison : la liberté !
L’écriture, c’est le prolongement de nos vies trop étroites. C’est la porte ouverte sur le monde. C’est la permission de minuit que l'on s'accorde le jour et la nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Plus d’autorité subie. Plus de règlement auquel se soumettre. Ni dieu, ni maître. ;-)