
Du cinéma dans l'édition...
 Elen Brig Koridwen s'est mise en scène avec soin... et voilette.
Elen Brig Koridwen s'est mise en scène avec soin... et voilette.Avant tout, bravo aux passionnés qui animent ce site et se démènent pour promouvoir les auteurs indépendants, mission à laquelle je ne peux qu’adhérer avec enthousiasme !
L’équipe m’a invitée à vous conter en exclusivité mon premier contact… atypique… avec les éditions Robert Laffont, non pour « Propos d’homme à homme », offert à la lecture sur monBestSeller, mais pour un autre de mes romans : « Zone franche ».
Un éclairage pittoresque sur le monde de l'édition
Plus de 20 ans après les faits, je ne me suis décidée à relater cette expérience que parce qu’elle apporte un éclairage pittoresque sur le monde de l’édition. Car l’affaire est à la fois cocasse et fort embarrassante. En vérité, j’en rougis rétrospectivement, tout en souriant malgré moi. C’était fou, transgressif, osé ; complètement déjanté, en fait… (À ma décharge, j’étais jeune. Aujourd’hui, je suis plus sage que les trois Sages d’Élie et l’Apocalypse !)
Avant tout, un mot du contexte.
Ma vie a été une chaîne de montagnes russes, hauts grisants et bas vertigineux. À tel point que publier ma biographie me vaudrait, je le crains, de passer pour mythomane… J’ai fréquenté des milieux diversifiés à l’extrême et pratiqué à travers le monde des dizaines de métiers, dont le rewriting n’était qu’un aimable contrepoint. De ce parcours à très haute tension, vous ne saurez rien hormis quelques bribes, même en me torturant à la gégène ou en me déposant un million sur un compte offshore !
En 1995, je me trouve, disons en disponibilité. Le problème, c’est que je suis ruinée. Ni pour la première, ni pour la dernière fois ; seulement, j’ai des enfants à nourrir, ce qui transforme une mère en Godzilla. Braquer une banque n’étant guère dans mes cordes, j’ai alors l’idée de me faire éditer. (Si, si, j’étais saine d’esprit ! Soumettre un manuscrit était, sinon un super bon plan, du moins quelque chose à tenter, la preuve : quelques années plus tard, la même maison d’édition me proposera un à-valoir stupéfiant pour « Les émigrés ».)
Je brûlais de dénoncer l'hypocrisie du système
Après ma déconfiture, j’aurais volontiers sangloté en me gavant de chocolat, mais je brûlais de dénoncer l’hypocrisie du système, et puis nous étions déjà à court de sucreries. À la place, je me suis enfermée pour écrire un roman défoulatoire, une romance sur fond d’économie parallèle ; pas le travail au noir, ni même la délinquance en col blanc, non : les affaires plus que douteuses orchestrées par les pouvoirs, celles qui remplissent des caisses noires et quelques poches au passage. Rédigé comme un témoignage, le livre a été bouclé en moins de dix jours, mes enfants affamés ayant fini par ronger la porte. OK, sur ce point j’affabule : ma mère veillait à leur laisser du pain dur à disposition…
Trêve de plaisanterie ; il me faut maintenant lâcher une confidence supplémentaire. J’ai grandi dans le milieu littéraire : parents libraires, père auteur ayant connu un certain succès, parrain académicien. Mais risquer d’être publiée par faveur aurait été le comble de l’humiliation. J’ai passé ma vie à brouiller les pistes à grand renfort de pseudos, alors pour couiner à l’aide, il aurait fallu que je me retrouve sous les ponts avec ma marmaille en pleurs.
Je n’ignorais rien de ce que représente, pour un auteur anonyme, l’étape des comités de lecture :
une épreuve entre le saut du mur de Berlin en pleine Guerre Froide et la remontée d’un torrent par un saumon sauvage – le frai en moins. Avant d’avoir une réponse, nous serions tous morts de faim.
Alors il m’est venu une idée parfaitement insane : j’allais exploiter le thème explosif de « Zone franche » en me faisant passer pour mon héroïne… Si ce n’est pas là le transfert le plus tordu de l’histoire de l’édition, voire de la psychanalyse, je veux bien manger toutes les boîtes de mouchoirs de Chris Simon en invoquant Lacan !
Voici, donc, le récit de cette mise en scène
Accrochez-vous, c’est presque du polar – pas façon Patrick Ferrer, dommage, mais on fait ce qu’on peut.
Je contacte les éditions Robert Laffont à partir d’un fax public : bonjour, je ne peux pas vous donner mon nom, mais j’ai à vous proposer un témoignage sur un sujet très chaud…
Comme je n’ai pas la fibre menteresse, je ne prétends pas que le livre raconte ma propre vie, mais je le laisse entendre (tout n’est pas inventé, d’ailleurs). Je joins le prologue du roman et indique que je rappellerai tel jour à telle heure, le temps qu’ils vérifient la crédibilité de mes dires ; la maison a forcément dans son réseau quelqu’un de très bien informé.
Rappel depuis une cabine. Je demande sans trop y croire à parler au directeur général, on me passe le directeur littéraire. À l’époque, il s’agit d’Antoine Audouard, un pur produit du sérail puisque fils d’Yvan Audouard, filleul d’Antoine Blondin et futur époux de Susanna Lea, le célèbre agent littéraire, qui est alors la directrice des projets internationaux.
Audouard et moi entamons un dialogue surréaliste. Il m’attribue un nom de code : « Géraldine ». Mon prologue a éveillé leur intérêt, me dit-il. Je lui explique que j’ai des prétentions en littérature, raison pour laquelle mon histoire cherche preneur. Puis je lui fixe rendez-vous dans la rue quelques jours plus tard, annonçant que je refuse de pénétrer dans les bureaux. C’est que je dois rester cousue dans la peau de mon héroïne, avec sa paranoïa d’usagère d’un monde en noir et glauque ; impossible d’accepter une entrevue ordinaire sans risquer d’être démasquée.
Les éditions Robert Laffont sont élégamment situées avenue Marceau, dans le 8e. Embusquée plus loin, je vérifie qu’Audouard s’avance seul sur le trottoir, pas seulement pour bien jouer le rôle de « Géraldine »… Aujourd’hui, avec The Blacklist et autres fictions, ma boulangère et mon kiné discourent de l’économie parallèle, mais dans ces années-là, le sujet est une vraie bombe. Si ma démarche a fuité, les autorités pourraient exiger mes sources.
Mince, d’allure cool avec sa chemise noire à col Mao, le jeune directeur littéraire – trente-neuf ans – voit venir à sa rencontre une « Géraldine » encore plus jeune, mais cent pour cent décalée : tailleur et chapeau à voilette (on peine à le croire, mais cet accessoire existait avant Amélie Nothomb). Et derrière elle, se tient un garde du corps !
Antoine Audouard s’en inquiète un peu, on le comprend. Non sans courage, il se rebiffe, veut repartir… et c’est le moment de bravoure, celui dont j’ai encore honte : mon gorille entrouvre sa veste, montrant qu’il est « enfouraillé », comme disent les flics et les voyous – avec lesquels il n’a rien à voir, je le jure sur la tête de mes enfants.
Ce geste rassurant emporte l’adhésion du directeur littéraire, qui réalise subitement que je suis une dame de bonne compagnie. Un rien guindé, il m’accompagne à la brasserie d’en face, dont j’ai oublié le nom.
Tandis que mon garde du corps « me couvre » depuis le bar, je m’installe dos au mur à une table avec vue sur toutes les entrées : j’ai le sens du détail, c’est le métier ! Pour briser la glace, qui s’est pas mal épaissie, le dirlit et moi prenons un verre ; mon thé fait plutôt Miss Marple que Mata Hari, mais tant pis. Lorsque je lui remets très officieusement mon tapuscrit, comme disait François Nourissier, le cher Antoine a toujours un peu de givre dans la voix, mais rendez-vous est pris pour la semaine suivante.
Huit jours plus tard, je me retrouve à la même table, avec mon ange gardien toujours en faction au bar. Face à moi, le duo de choc des éditions Robert Laffont en 1995 : Audouard, l’air encore un peu garrotté par son col Mao (ce n’est pas tous les jours, heureusement, qu’un auteur braque un éditeur pour lui fourguer son manuscrit) ; et le big boss en personne, Bernard Fixot, qui quelques années plus tard fondera XO Éditions.
Entré dans la profession en tant que magasinier, Fixot a gravi à la force du poignet cette longue pente très savonneuse, accomplissant le parcours le plus impressionnant de l’édition. Il s’est forgé chemin faisant une conception du métier très moderne, tout sauf élitiste. Efficace, direct, Bernard Fixot a « signé » Betty Mahmoody, l’auteur de « Jamais sans ma fille », quand nul n’y croyait. Il a pour le moins le sens des affaires, et si j’ai choisi sa maison, c’est parce que je ne peux pas l’imaginer crachant sur la bombe que promet mon « témoignage ».
Pourtant, il me soutient le contraire : « Les éditions Robert Laffont ne publieront jamais un livre pour son seul contenu, même si c’est le scoop du siècle. En revanche, une plume de qualité nous intéresse toujours. Et je peux vous le dire, mademoiselle : de toute ma carrière, je n’avais encore jamais rencontré un style comme le vôtre… » À sa droite, Audouard rythme cet argumentaire en hochant la tête.
Il serait tentant de les croire sur parole, mais en ce temps-là, je suis aussi incapable de confiance en moi-même qu’envers quiconque.
Mon analyse, c’est que Fixot drague ma plume pour rafler ma bombe ! Afin de me détromper, il nie tout intérêt pour mon « témoignage » et me suggère d’écrire un roman (le comble, non ?) Il le publiera, assure-t-il…
Trois ans plus tard, j’aurai la preuve qu’il était de bonne foi ; je lui ai fait par la suite les plates excuses que mérite tout éditeur ayant essuyé l’entêtement d’un jeune auteur.
Mais là, sur la défensive, je me crois soudain face à un partisan de la promotion canapé, fléau que Nila Kazar a eu le cran d’évoquer sur son blog Bazar Kazar. J’ai déjà été échaudée : le format 90-55-95, cela vous vaut trop souvent des offres de couverture, si je puis dire ! Et moi, je ne veux être couchée que sur les pages d’un livre, en caractères d’imprimerie.
Cependant, je dois absolument repartir avec un chèque d’à-valoir ; je m’obstine donc à vendre « Zone franche ». Tout en feuilletant le tapuscrit que son staff et lui ont déjà passé à la moulinette, Bernard Fixot tente, mine de rien, d’y passer « Géraldine » à son tour… Et soudain, peut-être pour m’amadouer, le grand éditeur déclare : « Vous savez, cet homme ne vous mérite pas ! Il ne vous arrive pas à la cheville ». (Le héros, souvenez-vous, est censé être mon chéri).
Allons bon ! Le canapé se rapproche dangereusement, présume l’échaudée. Qui compense par une attitude de plus en plus réfrigérante…
Et tout bascule. Las de cette incendiaire doublée d’une pisse-froid, Fixot décide d’acheter ma bombe, mais en imposant ses conditions. À moins qu’il n’ait toujours voulu en arriver là – je me garderai bien de le sous-estimer.
Je me retrouve sous le feu croisé des deux hommes qui m’expliquent que mon texte est trop distancié. Ils ont raison : là où d’autres ouvriraient en grand les vannes de l’émotion, j’élude, je pirouette, je badine. Les larmes, ça mouille, le sang, ça tache, et je serais marrie d’infliger cela au lecteur au lieu de le faire sourire. Il n’est pas obtus, le lecteur, il n’a pas besoin de patauger dans l’hémoglobine pour s’émouvoir…
À bout d’arguments, Audouard me sert un exemple qui semble l’avoir marqué, l’histoire d’un viol que le lecteur vit par le truchement d’un verre d’eau posé sur la table. Je n’ai jamais lu le roman, il est sans doute magistral. Mais ce jour-là, je désespère : si ça, ce n’est pas distancié ! Moi, pour décrire un viol, je n’irais pas donner la parole à un verre ; je me sens infoutue de faire ressentir à un lecteur les émotions du pauvre récipient – spectateur impuissant, si j’ose dire. (Ou celles de l’eau : Flaubert aurait misé sur l’eau comme métaphore de l’acte, faute d’une lettre déchirée fusant par une portière).
Trêve de références pédantes ! Je veux bien avouer que ma scène de viol dans Zone franche est vite pliée. Top chrono : prise vicieuse ; gifle en retour ; monsieur persiste ; coup à l’entrejambe, fin de l’histoire. Moi, j’aime bien, mais pas mes interlocuteurs. Sans doute parce que eux n’ont jamais été violés.
L’ambiance continue à se tendre. Chaque nouvelle petite critique me persuade que les compliments n’étaient qu’une entrée en matière, le bouquet qu’un homme nous offre avant un dîner galant. (S’il pouvait espérer conclure en nous refilant plutôt le Kama Sutra en BD, croyez-moi : les fleuristes feraient faillite).
Bernard Fixot finit par énoncer la proposition qui tue : me faire aider par l’un de ses « écrivains maison ». Il l’ignore, mais je suis bien placée pour savoir qu’il s’agit de réécriture – processus que j’ai décrit il y a quinze jours sur mon blog.
Je commets alors l’erreur de débutant évoquée dans un autre article de Bazar Kazar : je me vexe. (Oui, Nila, je suis une idiote). Si mon style est aussi bon qu’ils le prétendent, pourquoi ne pas juste me conseiller, superviser mon travail de remaniement ?
Ah, ben tiens, voilà la réponse : « Bien entendu, vous partagerez les droits avec notre co-auteur… »
Bien entendu. En une phrase, mes droits d’auteur ont fondu de moitié : 5%. Au profit de l’éditeur, me dis-je, puisque le co-auteur maison ne touchera que son salaire…
Tenter de négocier ne me vient même pas à l’esprit. Je me lève, et mon mètre soixante rehaussé d’un chapeau à fleurs laisse tomber ma propre condamnation : « J’ai la prétention d’être plus à même de réécrire mon propre livre ». (Je sais : ce que je prends alors pour de la dignité est, en vérité, ridicule.) J’abaisse ma voilette façon rideau de fer, je siffle mon chien de garde et nous voilà partis, les laissant contempler leurs verres – des fois que le contenu aurait un viol à raconter.
Cette épopée eut une suite en 2 actes – pas banals non plus, mais j'ai déjà été trop longue. L’important, mes ami(e)s, c’est que je ne regrette rien : je suis libre comme l’air et j’ai le privilège de dialoguer avec vous. À l’heure où j’écris ces lignes, « Zone franche » est dans le top 50 Amazon, tandis que si j’avais signé en 1995, il n’aurait plus d’existence. La carrière d’un livre édité est le plus souvent éphémère… En revanche, les réseaux de lecteurs, le monde des indés, bref la chaleur humaine, c’est mon trip !
Une petite morale pour la route ? Amis auteurs, n’essayez surtout pas d’imiter mon subterfuge éhonté. L’affaire semble avoir fuité, et l’on vous verrait venir. En outre, notre époque n’a plus trop le sens de l’humour ; le procédé serait très mal perçu…
Merci encore à monBestSeller pour m’avoir offert une si grande liberté d’expression, et excellente lecture/écriture à toutes et à tous !
Elen Brig Koridwen

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…








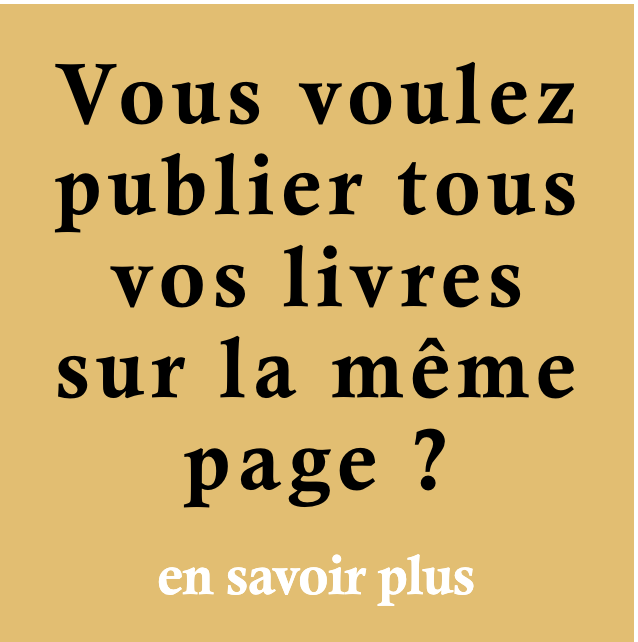
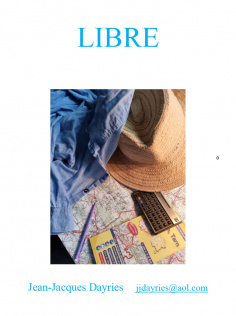

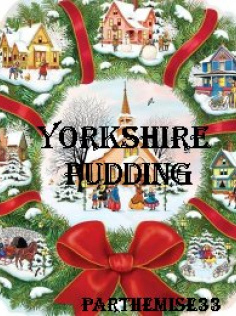


Très bon Elen. Je bois du petit lait et me remémore mes propres débuts à cette époque (N'étant, pour ma part, pas issu de ce milieu) où j'avais proposé mon premier roman (aventure) à un "éditeur" (à compte d'auteur) qui ne sera finalement jamais publié,lui. CC
@BOSSY : Ma foi, cher monsieur, je me suis sauvée aussi, et comme je le dis en conclusion, je suis très heureuse d'être un auteur indépendant, tout comme vous. :-)
Oh, que j'aurais voulu être à votre place, quelques années auparavant ( 1970 ) chez un autre "grand" Editeur ! Quand on vous dit:"C'est excellent, nous allons le refaire !". Je n'ai pas fait comme vous: je me suis sauvé, au Pérou, et tous les jours de ma vie j'ai remercié le ciel de n'avoir pas été édité ! J'ai récemment rencontré mBS, c'est ce que je cherchais. Vive eux et vive nous !@Elen Brig Koridwen
Fascinant ! l’un de vos pseudo serait il Mata Hari et l’autre Agatha Christie ?
Une femme et une auteure que j'admire pour son courage, sa lucidité... et comme ma Claire, par sa culture et sa détermination. Merci pour ce partage . MC
Très drôle cette aventure!
Bravo pour le courage!
Mais on ne peut pas faire cette promesse :
"Cette épopée eut une suite en 2 actes"
en toute impunité.
Il faut passer à table! :-)