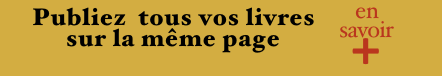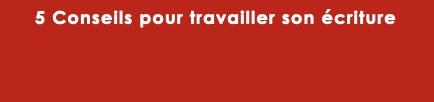"Le sourire du soldat" : Coup de coeur du Concours de nouvelles monBestSeller 2019

LE SOURIRE DU SOLDAT de Bossy
À l’époque, on allait à l’école à pied. Les petits comme les grands. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. Par les grands froids ou les grosses chaleurs. Que l’école soit proche ou lointaine. Qu’on soit triste ou joyeux. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas. Content ou pas content. Tout seul ou en bande. Par temps de paix ou pendant la guerre. On ne choisissait pas.
Moi, j’allais à l’école avec ma grande sœur. C’était un avantage ou un inconvénient selon les derniers événements et les différends qui restaient à régler ou au moins à éclaircir… C’était à la fin de la guerre 39-45, quand les Américains voulaient chasser les Allemands du territoire qu’ils occupaient. Ils bombardaient la ville régulièrement avec la précision approximative des attaques déclenchées par des avions volant à haute altitude pour éviter les tirs des canons antiaériens. C’était plutôt pendant la nuit ou au lever du jour… Les bombes étaient essentiellement destinées à détruire le port de la ville d’où s’embarquaient les soldats pour fuir avec leur matériel. En réalité,elles tombaient plus souvent sur les maisons avoisinantes ou carrément dans la mer. Les habitants, alertés de l’imminence du bombardement par les agents de Défense passive, s’engouffraient dans les caves avec l’espoir d’échapper à un sort incertain. Ma mère ayant décrété une fois pour toutes qu’elle préférait mourir dans son lit que sous des gravats de pierres, nous étions dispensés de la fuite générale sous l’immeuble, et les enfants se précipitaient aux terrasses pour assister au magnifique spectacle des maisons en feu et des immeubles qui s’écroulaient. Le bruit des vagues successives des avions se confondait avec celui des explosions qui secouaient le quartier, provoquant notre stupeur et notre enthousiasme. Les bombes s’éparpillaient en éclats de ferraille brûlants dont nous faisions collection pour garder le souvenir de ces années terribles.
C’est ainsi que je faisais ma provision pour planter les décors de guerre de mes soldats de plomb. J’avais déjà une belle armée de figurines dont je complétais le nombre par des acquisitions de différentes provenances. Mes batailles exigeaient toujours plus de combattants et le chemin de l’école m’offrait la possibilité de diversifier mes sections d’assaut, grâce au marchand de jouets qui avait planté sa vitrine alléchante au beau milieu du parcours. C’est ainsi que chaque jour, au grand désespoir de ma sœur, je ménageais une petite halte devant sa vitrine, impatient de découvrir la merveille que je convoitais pour déclencher, moi aussi, une guerre sans merci et tuer beaucoup d’ennemis. Puis nous repartions d’un bon pas espérant ne pas manquer les combats aériens qui se déroulaient au-dessus de l’aéroport situé non loin à notre droite, où l’occupant avait concentré ses avions de chasse pour attaquer les vagues de bombardiers qui se succédaient pour le bouter hors du territoire.
Ce jour-là, par un beau matin déjà ensoleillé, une féroce bataille aérienne avait éclaté entre les chasseurs qui accompagnaient les bombardiers et ceux de l’occupant qui tentaient de conserver la maîtrise du ciel. C’étaient de belles voltiges et cabrioles qui emplissaient l’espace de montées et descentes vertigineuses, de croisements et frôlements dangereux, ponctués de tirs de mitrailleuses assourdissants. Un spectacle de premier choix pour moi,qui faisait trembler ma sœur,morte de peur. J’étais fasciné par les avions qui piquaient soudain à la verticale pour s’écraser au sol dans un geyser de flammes et de terre, tandis que d’autres se redressaient violemment à la poursuite de plusieurs cibles en fuite. Ma sœur trépignait pendant que je comptais avec émotion les victoires des uns et les défaites des autres. C’était beau, la guerre !
Puis, il y eut une accalmie et un long silence succéda aux sifflements et pétarades qui avaient entouré l’embrasement du ciel. Nous repartîmes vaillamment, ma sœur devant, moi traînant des pieds, les yeux pleins des merveilles guerrières. Le but, c’était l’école, mais avant tout, la petite place où se dressait le bivouac de l’ennemi qui nous attendait avec de grands gestes amicaux pour nous offrir de gigantesques tartines beurrées recouvertes d’une épaisse couche de confiture en guise de petit déjeuner. Malgré ses protestations mensongères, je savais que là résidait la principale raison pour ma sœur d’arriver le plus vite possible et cela m’amusait beaucoup de freiner notre marche lorsque nous approchions de ce lieu de toutes les gourmandises.
Nous arrivâmes à hauteur de l’immense bâtisse à deux étages toute blanche qui était surmontée d’un large drapeau blanc plaqué d’une croix rouge d’un bord à l’autre. La cour plantée d’oliviers d’âge vénérable était précédée d’un lourd portail en fer toujours grand ouvert. À cette heure matinale,il n’y régnait pas une grosse activité. Nous allions nous en éloigner lorsquesoudain, un side-car fit irruption à grande vitesse, dont le chauffeur, tête baissée, criait en moulinant d’un bras pour s’ouvrir le passage. Une forme indistincte occupait le bac latéral. Il franchit le portail en trombe, tandis que les infirmières se précipitaient dans la cour pour secourir le blessé. Je traversai la route en courant, le cœur battant d’émotion, devinant qu’un événement grave se déroulait sous nos yeux. Ma sœur me cria de revenir et les infirmières tentèrent de m’écarter.
– Ce n’est pas un spectacle pour les enfants ! hurlaient-elles en me tirant par le bras.
Mais je voulais voir, je voulais savoir de quoi il s’agissait. Je réussis à m’accrocher des deux mains au rebord du side-car, malgré tous les efforts du personnel pour m’en dissuader. Un soldat gisait dans une sorte de baignoire remplie de liquide rouge vif. Les battements de mon cœur s’accélérèrent. Le soldat ne bougeait pas, vêtu de son uniforme, mais tête nue, très pâle, penchée vers son épaule. Une douleur violente m’étreignit la poitrine. Deux infirmières tentèrent de soulever le blessé pour l’extraire de la flaque de sang dans laquelle il baignait, mais il était trop lourd et il glissa entre leurs mains avec un grognement sourd. Mon émotion était à son comble. Je voulus participer au sauvetage en tendant un bras trop inutile vers le soldat effondré dans cette horrible baignoire pleine de son sang qui continuait à s’échapper de son corps. Pendant un temps, il bougea sa tête de droite à gauche puis de gauche à droite, les yeux tournés vers le ciel. Il avait un visage très pâle et une belle chevelure blonde s’écroulait en boucles derrière ses oreilles. Puis il se raidit. Sa tête s’immobilisa, et il me fixa de ses yeux bleus et clairs. Je tendis une main vers lui pour l’aider. Je tremblais de tous mes membres. Une infirmière me tirait en arrière pour m’éloigner de ce drame qui n’était pas pour les enfants. J’étais hypnotisé par ce regard perçant devenu fixe dirigé vers moi avec une insistance effroyable, et je me cramponnais désespérément au rebord du side-car pour ne pas perdre l’appel de ces yeux qui ne voyaient plus rien.
Sans le savoir, c’était la première fois que j’étais confronté à la Mort. Je crus un instant que le soldat me souriait. Et je crus que la Mort était un homme blond aux yeux très bleus qui avait un regard d’une infinie douceur souriant à un enfant.

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…