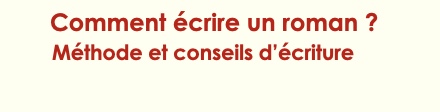Un moment, en vous lisant, je me suis cru chez H. Murakami, en voyant le fantastique surgir à la lisière du quotidien, comme un rêve qui se serait infiltré sans fracas dans la réalité. Chez Murakami, l’étrange provient par exemple de l’irruption d’un chat qui parle, ou de l’image d’une jeune fille mystérieusement disparue. Ces éléments irréels induisent une forme de trouble léger. Chez vous, ce glissement imperceptible vers le fantastique se matérialise par cette pièce d’or, ce puits étrange (chez Murakami, il aurait été sans fond), une machine à écrire mythique…
Si l’absurde est une composante de notre univers ou peut-être un miroir déformant du réel comme chez Freud, le surnaturel devient une métaphore de la solitude ou de l’inconscient, nous permettant ainsi d’explorer les zones d’ombre de l’âme humaine.
Publié le 03 Juillet 2025