
LES CLASSIQUES : James Oliver Curwood et moi
 Curwood à droite : entre littérature et cinéma
Curwood à droite : entre littérature et cinémaA sa mort, il était l’auteur le mieux payé au monde. Son studio d’écriture (eh oui nous sommes proches d’Hollywood) « Curwood Castle » est maintenant un musée à Owosso dans le Michigan.
Alors partons à la découverte de cet illustre auteur, inconnu pour certains, mythique pour d’autres...
James Oliver Curwood (1878 - 1927) : un aventurier de naissance
« Un son rauque qui n’était même pas un cri ; ce fut tout ce que put produire la gorge de Jim quand celui-ci vit se dresser le grizzly monstrueux. »
C’est dans le Michigan, dans ces États-Unis qui succédaient tout juste à la conquête de l’Ouest que, le 12 Juin 1878, voit le jour un garçon auquel ses parents donnent un nom chantant, si agréable à prononcer : James Oliver, Curwood. Un petit benjamin de quatre enfants qui va s’éprendre curieusement de deux amours qu’il saura conjuguer : la nature vierge des montagnes sauvages, et l’écriture. Si le garçonnet se montre médiocre dans ses études, il commence à concevoir des histoires à peine âgé de huit ans. Et son indubitable goût pour la contemplation qui naît des voyages aux confins, se lit déjà dans l’aventure qu’il va vivre cette même année : il va entreprendre un tour du sud des États-Unis en bicyclette ! Si jeune, James Oliver se découvre un attrait pour ce qu’il prendra pour une passion : la chasse.
Un siècle de distance entre deux écrivains épris de nature sauvage
C’est cent six ans plus tard, quelque part en France, que voyait le jour la fillette passionnée que j’allais devenir. Une fillette qui allait tomber amoureuse de ce qui avait tellement ému James Oliver Curwood. Autre époque, autre siècle, autre contrée, autre langue, et des destins liés. J’avais une dizaine d’années quand on m’a offert ce livre, curieusement titré Le Grizzly. On voyait, en couverture, cet ours superbe, l’œil empourpré, la gueule béante, s’imposer à quelques mètres d’un chasseur dont le chapeau couvrait les yeux et dont le fusil, étrangement, ne pointait guère vers la bête. Une tension évidente était déjà née dans mon esprit. Un irrésistible attrait de comprendre ce qui était en train de se passer sous ce ciel en feu, au bord de cette corniche enneigée.
James Oliver avait été plus éloquent. Son œuvre originale titrait : The Grizzly King’. Le Roi Grizzly. Mais je n’avais pas besoin de le savoir. J’avais déjà compris que j’allais au-devant d’une inoubliable rencontre.
« La première pensée de Jim fut la certitude de son impuissance, de son impuissance absolue. Il ne pouvait même pas fuir, acculé qu’il était à la muraille rocheuse. Quant à sauter dans la vallée, cela eût représenté une chute de trente mètres. Oui, il était perdu. ».
Perdu. Les moindres mots de James vibraient en moi. Ils y vivaient de réalisme, de vérité, d’absolu. Ah, j’en avais sautés, des ruisseaux, j’en avais admirés, des torrents furieux domptés par des gels implacables. Toute ma vie se dessinait dans ces monts sublimes couronnés de sapins aiguisés qui rivalisaient de zèle pour écorner le ciel bleu, si lumineux. J’en étais folle, de ces rochers, de ces herbes sauvages, de ces parfums de genêts, de narcisses et de serpolets acidulés qui égayaient les sentiers les plus inconnus auxquels nous allions, avec ma famille, nous accrocher comme des isards. Et moi qui, sous ce prétexte, m’imaginais toujours amérindienne, nomade, confrontée aux plus belles merveilles des terres incultes, comment ne les aurais-je pas adoptées, ces Rocheuses qui depuis, exercent sur moi tant de fascination dévouée ? Passionnée de lecture, je faisais rarement le pas, à cette époque, de comprendre qui étaient les auteurs de mes œuvres favorites. J’avais trop besoin qu’ils existent, mes héros et mes héroïnes, aux côtés de qui je passais tant d’heures enflammées. Je ne voulais pas penser à cet écran d’imagination qui floutait mes impressions lorsque je pensais aux personnes qui les avaient fait surgir du néant, et auxquelles j’offrirais, plus tard, mes remerciements amicaux. Mais, dans le cas de James Oliver Curwood, la question ne s’est même pas posée.
« Les mots de James Oliver n’étaient pas nés de sa seule imagination géniale. Ils étaient empruntés au vécu ! »
« Pourtant, en ces ultimes moments, la terreur ne lui fit pas perdre sa lucidité. Il distinguait jusqu’à la rougeur qui colorait les yeux altérés de vengeance du formidable fauve, la cicatrice qu’avait laissée l’une de ses balles en labourant la peau du crâne, et l’endroit dépourvu de poils où une autre balle avait pénétré dans l’épaule. ».
Après avoir passé avec succès l’examen d’entrée à l’Université du Michigan, James Olivier Curwood entreprend des études de journalisme et devient journaliste pour le Detroit News Tribune. Pourtant, en dépit des perspectives de faire une brillante carrière, il interrompt son activité en 1907, dévoré par la soif de l’écriture et des grands espaces. C’est naturellement qu’il se rapproche du Canada pour se consacrer à la conception de ses romans, dont la publication lui vaut une certaine notoriété. En 1909, il est un homme mûr qui a trois enfants, nés de deux unions, et cependant, il vit une moitié de l’année dans le Grand Nord, habitant des cabanes qu’il a parfois construites, nourri du produit de ses chasses.
Je l’avais senti. Les mots de James Oliver n’étaient pas nés de sa seule imagination géniale. Ils étaient empruntés au vécu. D’une manière ou d’une autre, le récit de Jim, le héros du Grizzly, était autobiographique. Une telle intuition, sourde, secrète, renforçait ma conviction : Tyr, l’ours superbe, était vivant quelque part. Il n’était pas un mythe. Il n’était pas un faire-valoir. Il était là.
Curwood : La nature emportée, les caractères joueurs, les visées obtues, l’ambition déraisonnée.
« Lentement, un grand doute se répandait dans le cerveau rudimentaire de Tyr. Était-ce vraiment cet être recroquevillé, inoffensif, épouvanté, qui l’avait blessé ? Il sentait bien l’odeur de l’homme, odeur âcre déjà perçue à d’autres moments. Cette fois cependant aucune souffrance ne s’y associait. ».
C’était cela qui me fascinait. L’incroyable majesté de l’ours. Sa présence. Son charisme. James Oliver Curwood avait accompli une prouesse. Quand son roman mettait en scène des êtres humains, des hommes, chasseurs, explorateurs, trappeurs et conquérants, téméraires et brailleurs, impossibles et attachants, je reconnaissais tout ce que je connaissais déjà. La nature emportée, les caractères joueurs, les visées obtuses, l’ambition déraisonnée. Quand il campait Tyr, le seigneur des crêtes et des vallées, grand, fort, étranger aux violences volontaires, qui régnait de haut sur un monde qu’il voulait protéger et non pas asservir, il mettait en lumière des valeurs qui devaient m’ébranler jusqu’aux tréfonds de l’âme. Courage, vaillance, hauteur, clémence : autant de traits essentiels qui manquaient aux cœurs des hommes et révélaient des vides béants. Une image négative en opposition à la rude miséricorde de l’ours. J’ai passionnément aimé le grizzly, et je l’aime encore, pour m’avoir montré, du relief acéré de sa personnalité que Curwood s’est empêché d’anthropomorphiser, les creux d’écoute et de tendresse qui devraient remplir nos propres cœurs humains.
« J’avais décidé de tracer mon chemin pour ne jamais perdre tant de vérité, pour en identifier la source. »
« Alors, toujours avec grâce, Tyr retomba sur ses pattes et regarda fixement Jim. Si ce dernier avait bougé, il était mort sans rémission. Mais Tyr n’était pas, comme l’homme, un spécialiste de la mort des hommes. Une demi-minute encore, il attendit un mouvement menaçant, l’ombre seulement d’une menace. […] Puis, toujours lentement, comme avec une hésitation, il fit volte-face. ».
La tension avait été si forte, l’émotion, si puissante, que j’avais été incapable de gravir ces lignes à moi seule. Ma mère avait repris la lecture pour moi. Quand, de sa voix tellement aimée, elle a articulé ces mots, j’ai cru que mon cœur avait explosé. J’avais tout compris. La beauté. La miséricorde. Où nos vies pouvaient trouver de la grandeur. Tyr ! Tyr s’était détourné là où il y avait eu tant de cruauté, tant de méchanceté, tant d’acharnement. D’un seul mouvement, il aurait pu déchirer Jim. Qu’il ait seulement lâché la tenaille implacable de sa mâchoire d’acier sur celui qui lui avait tout appris de la défiance, de la peur et de la douleur, et l’homme mourait, victime de ses propres accès de stupidité. Mais non. Le monde existait encore. La faute se pardonnait. Il y avait encore le ciel. Il y avait encore l’air à prendre à goulées, les cimes à contempler, le ciel à aimer à la folie. La vie.
« Alors Jim sentit qu’il respirait encore et que son cœur se remettait à battre. Il poussa un grand soupir, comme un sanglot. Quand il se redressa, ses jambes le portaient à peine. […] À quelques trois cent mètres devant lui, Tyr s’éloignait au trot, sans hâte. […] Alors Jim se mit à rire, d’un rire à la fois nerveux, joyeux et tremblant. ».
Pendant des mois je fus obligée de garder le livre auprès de mon lit si je voulais bien dormir. Parfois même, je le posais sur l’oreiller.
James Oliver Curwood a quarante-neuf ans et se trouve en Floride quand, en 1927, il est mordu à la cuisse par une araignée. C’est du moins ce que raconte l’Histoire. S’en suivront des complications qui mèneront ce grand explorateur et merveilleux écrivain au terme de son voyage ici-bas. Il décède le 13 août de la même année.
Mais il était bien vivant quand j’ai lu ces lignes simples et tellement intenses qui venaient de m’ouvrir les portes d’un monde réel, d’un monde de vérité que je ne devais cesser d’arpenter depuis, jusqu’à ce que j’obtienne mes réponses, jusqu’à ce que je comprenne comment faire de ce rêve une réalité. Pendant des mois je fus obligée de garder le livre auprès de mon lit si je voulais bien dormir. Parfois même, je le posais sur l’oreiller. Je m’étais éprise à l’infini de ce qu’avait découvert James Oliver Curwood. J’avais décidé de tracer mon chemin pour ne jamais perdre tant de vérité, pour en identifier la source. Au cœur de mes montagnes sauvages, je pense souvent dans le vent à cet homme dont les mots se murmurent encore et qui, par-delà un siècle plein, a jalonné ma route en écrivant la sienne. Et je tressaille encore lorsque je vois, au loin, sur une pente rousse et acérée, entre les rocs gris, bouger une forme indistincte. Ce pourrait être Tyr, venu pour moi.
« Satané vieil ours !, murmura Jim avec émotion. Cette bête… cette bête sauvage a dans le cœur plus de générosité qu’un homme ! Car moi, si je l’avais coincé de cette façon, je lui aurais probablement fait son affaire… Mais toi, vieux grizzly, tu m’as laissé la vie ! ». En lui, Jim, ce jour et cette heure avaient si profondément gravé leur souvenir et leur sens, qu’il ne pourrait jamais les oublier. ».
Le saviez-vous ?
> On l’apprend vite quand on souhaite faire la connaissance de James Oliver Curwood : le romancier aurait eu, parmi ses aïeules maternelles, une authentique princesse indienne.
> Le face-à-face du Curwood et de l’ours clément est un élément d’autobiographie. Autrefois chasseur invétéré, James Oliver Curwood changera ses opinions après avoir vécu cette inénarrable expérience.
À lire absolument, si ce n’est déjà fait !
> Le Grizzly, bien sûr, pour marcher sur les traces d’un merveilleux qui n’a rien de fantastique, à la croisée des chemins entre la rédemption de Jim Langdon et l’humanisation de Tyr, le roi de la montagne sauvage.
> Kazan, le roman le plus célèbre de James Oliver Curwood.

Publier gratuitement votre livre
Vous avez écrit un livre : un roman, un essai, des poèmes… Il traine dans un tiroir.
Publiez-le sans frais, partagez-le, faites le lire et profitez des avis et des commentaires de lecteurs objectifs…




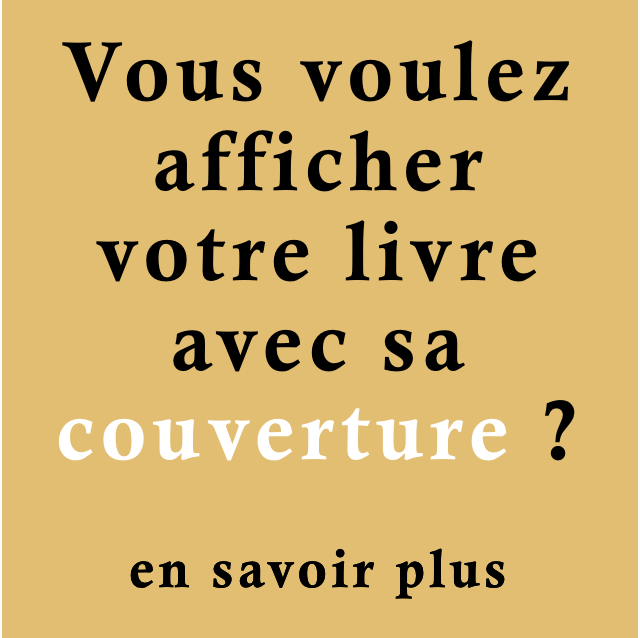
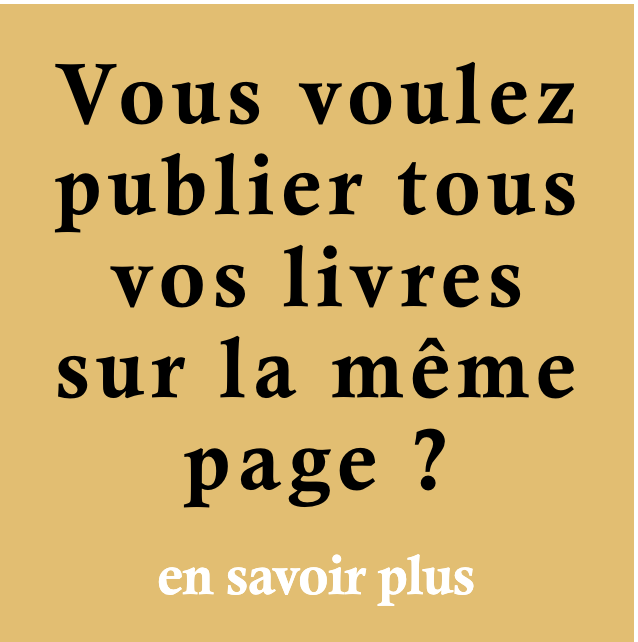


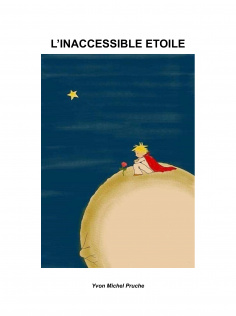

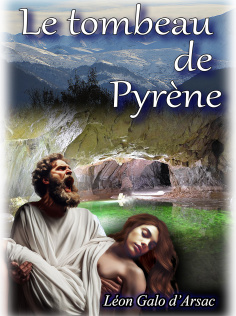
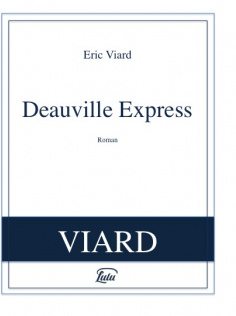

Très bon auteur, j'adore
@Élisabeth M.AINÉ-DUROC ,J'ai découvert CURWOOD depuis peu,j'adore, je suis fan,j'aimerai pouvoir lire l'ensemble de son œuvre malheureusement pas facile à trouver. Très bonne analyse, je me retrouve dans cet article.
Bonjour chère @chathymi, votre commentaire me touche beaucoup, et je vous remercie de m'avoir partagé votre impression. De mon côté, je connais bien ce sentiment que vous avez eu touchant ces "ours" que l'on rencontre : j'y suis passée moi-même ! Et je suis heureuse d'apprendre que vous êtes parvenue à les regarder dans les yeux, heureuse que vous ayez trouvé de bonnes forces et tout le courage nécessaire. C'est également mon cas, et il est probable que, sur ce parcours, ce face à face avec Tyr, vécu dans mon enfance par les yeux de Jim, m'ait un peu aidée...
En ce qui concerne votre envie de lire le roman de James Oliver Curwood, je suis plus qu'honorée d'avoir suscité chez vous cet enthousiasme ! Toutefois, si vous voulez faire un tour du côté de l'échange que nous avons eu avec Pierrick (juste en dessous !), et prendre connaissance de sa remarque autant que de ma réponse si ce n'est déjà fait, vous verrez qu'il est possible que le style de l'auteur ne plaise pas à tout le monde. Il y a quelque chose de simple et d'enfantin chez Curwood, une écriture jolie, poétique, mais un peu pataude pour qui a coutume de côtoyer les 'Grands'. C'est aussi ce qui le rend attachant, de mon point de vue ! Et puis, il faut aimer les grands espaces, la solitude désertique, et le règne animal... N'hésitez pas à me donner votre point de vue en retour, que vous ayez pu achever cette lecture ou non.
Je vous souhaite une belle fin de journée, de très bonnes Pâques, et une excellente continuation. À bientôt peut-être !
Élizabeth.
@Élizabeth M.AÎNÉ-DUROC
Bonjour Elizabeth. Je ne connais pas cet écrivain. Mais vous le louez si bien que je vais aller lire votre Ours.
En vous lisant je me disais que, dans la vie, il arrive que nous nous retrouvions face à un ours. Et parfois, c'est très très dangereux. J'en ai beaucoup rencontré de ceux là. Jeune, ils me faisaient si peur que je fermais fort mes yeux. Puis, plus j'ai vieilli, plus je les ai regardé, ces ours là, bien en face, non mais....Passez de bonnes Pacques. Amicalement, ChA
Bonjour @Pierrick Blin-Paulin, je vous remercie d'avoir commenté cet article. Je dois dire que je comprends tout à fait ce que vous avez pu ressentir à la lecture des textes de James Oliver Curwood. Enfant, transportée par ses descriptions très vivantes, je n'ai pas été insensible à ce caractère légèrement pataud qui émane de ses écrits. C'est ce que j'ai trouvé touchant, je crois, cette belle écriture un peu bancale, très intuitive, qui trahissait bien plus un vécu transporté qu'une étude de style. Je le reconnais : pas simple de classer les auteurs, et d'identifier parmi eux, à la lumière de nos expériences, qui sont les génies dignes d'être appelés "Classiques" ! Disons que j'ai fait figurer parmi les Stradivarius et autres violons subtils, une petite boîte à musique qui m'avait enchantée par sa chanson tintinnabulante. Ça peut prêter à sourire... Et cependant, je me rappelle avoir été touchée par la maîtrise de Jack London, lu également avidement, dans la même période. J'espère qu'un jour quelqu'un ici écrira un article sur lui !
En vous disant à bientôt peut-être, je vous souhaite cordialement une bonne continuation,
Élizabeth.
@Élizabeth M.AÎNÉ-DUROC
Article sympa mais on est quand même loin de MONSIEUR Jack London !!! J'ai lu un peu Curwood. Très sincèrement, cela ne m'a pas transporté. Une écriture très redondante et l'on sentait que le bonhomme écrivait à la chaine pour assurer son train de vie, ce qui en soi n'est pas honteux. De là à le considérer comme un écrivain majeur, il faudrait peut-être ne pas pousser grand-mère dans les orties.